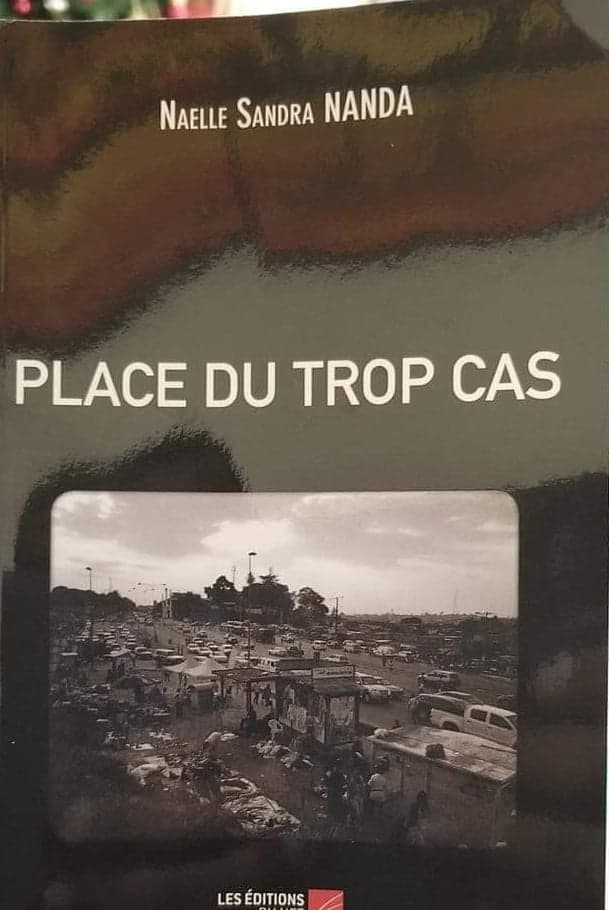La Bavure du destin, chronique d’un roman velléitaire
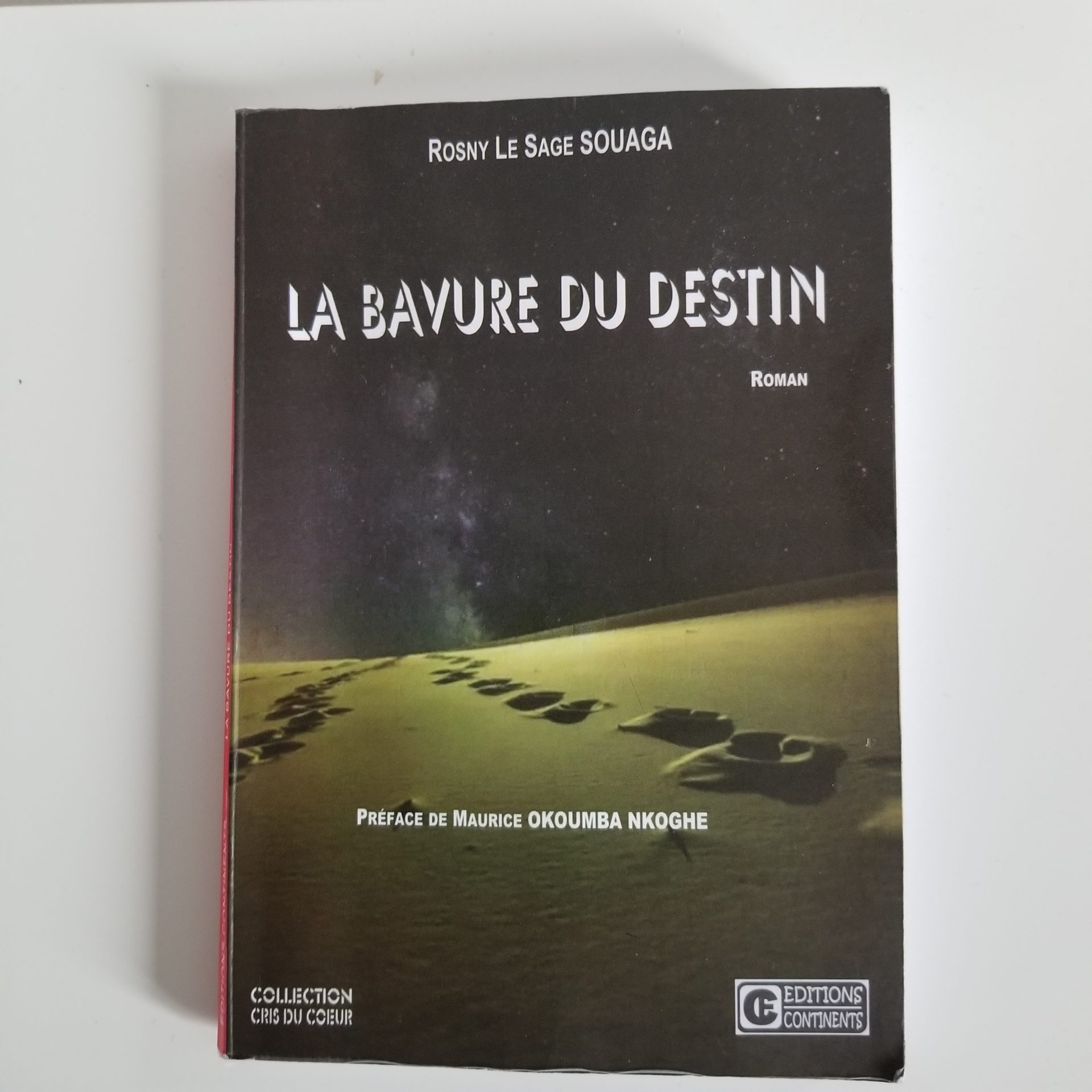
Rosny Le Sage Souaga a publié son premier roman. Notre chroniqueur l’a lu. Le Chant de Powê vous invite à le lire et à vous faire votre opinion. Lecture.
La bavure du destin, chronique d’un roman velléitaire
Au terme de la lecture de La Bavure du destin, nous avons eu envie de nous écrier comme Sylvester Stallone[1] : « Mais où est le mambo, le cuchi-cuchi, le tchatcha, la b…se quoi ! ». Tant l’œuvre de Rosny Le Sage Souaga brille par sa pudibonderie. Pourtant, il faut le reconnaître, on peut déjà apprécier honorablement la rigueur janséniste du style. Mais tout ceci s’évapore vite tant l’œuvre n’est qu’un ensemble de bonnes intentions. Des velléités. En outre, il emprunte des schémas éculés. La révolution, la profondeur et l’originalité esthétiques attendront encore un peu et la répétition du pareil et du même ne pouvait trouver meilleur continuateur.
L’ouvrage tient dans une main d’adulte et comprend une centaine de pages. Voilà pour les mensurations. La laconique préface de Maurice Okoumba Nkoghe devait apporter du poids à l’ouvrage frappé de rachitisme. Et en la lisant, on a quelque peu cerné l’intrigue : une idylle entre un éphèbe et une naïve naïade qui tourne court. Le tout encouragé par une parentèle de part et d’autres irresponsable et qui a confié son humanité au premier clébard venu, rencontré aux encablures d’Ayol-City[2] ou de Nzeng-City[3] c’est selon. Irresponsables comme le jeune homme qui se défile quand le bourgeon semé point à l’horizon. Difficile de faire plus classique. Quand le doyen qualifie l’histoire comme étant « poignante », on peut se demander si le spectacle de stand up a déjà commencé.
En nous dédicaçant l’œuvre, l’auteur nous enjoignait d’aller « en profondeur » et de ne pas rester en « surface » dans notre lecture. L’ordre martial fut donc donné. Cachet d’authenticité à l’appui ! Venant d’un « Écrivain-Poète-Romancier » (sic) sous le drapeau, il faut obéir. Par les temps qui courent sous l’Équateur, un refus d’obtempérer et une salve de somation est vite arrivée. N’étant ni belliciste ni téméraire, nous avons donc plongé en quête de cette « profondeur ». Mais nous nous somme retrouvé à barboter dans un étang littéraire et à la « surface », pas un nénuphar à se mettre sous la dent. Tout se passe comme si l’auteur avait commis son ouvrage avec, à l’esprit, le couperet de la Haute Autorité de la Cens… euh de la communication (HAC)[4]. Sinon, allons comprendre pourquoi ce livre essentiellement basé sur la séduction, le jeu amoureux, l’érotisme, la luxure, s’emploie-t-il à censurer les scènes suggestives ou du moins à les passer sous l’éteignoir… À peine quelques enfantillages entre Ovendeh et Ovoussougha que déjà c’est fini. « Qui a éteint la lumière ? » est-on tenté de demander. « Chérie, y a pas les mamboko[5] dans ton bouillon. C’est indigeste ! ». A l’époque, au Cinéma d’Akébé, au moment où Stallone enjaille Sandra Bullock et qu’interviendrait une de ces habituelles coupures de bande dont on nous gratifiait intempestivement, nous aurions crié : « Remboursez !!Remboursez !! ».
Et puis, il y a cette fin qui vous laisse sans voix, l’auteur ayant voulu ajouter de la tragédie au drame avec cet accident de la circulation digne d’une apparition d’Ovni. Et avec la voix de Dieudonné, on a envie de dire : « Mais qu’est-ce que ça vient faire là ? »
Les scènes érotiques sont à nos yeux l’un des exercices littéraires les plus audacieux. C’est ici que se jauge la puissance et l’imagination du créateur. Rares sont ceux qui comme Jean-Paul Sartre ont su percevoir la puissance érotique de la Négritude là où on n’y voyait qu’un concert de contestations et de proclamation de la fierté noire. De même que dans cette invite d’Edgar Moundjegou à Ilam : « presse ta main sur le bouton de nos nuits chaudes», il ne s’agit plus seulement de l’auteur de « Aux dieux de ce monde » de « Réveil de l’Afrique » ou encore de « Arrête-toi un moment ». Et quand nous parlons d’érotisme, cela n’a rien à voir avec la simple description basique, terne et racoleuse des élans coïtaux.
Outre les scènes érotiques, il a manqué également à cette œuvre une description crue du monde interlope des lupanars, on aurait dû avoir droit par exemple à un défilé de pontes du pays décrits dans des postures viles ou s’offrant corps et âmes aux jeux de la luxure, en guise de débouché à leur trop-plein de compromissions politiques… Tout comme il a manqué aux personnages une certaines épaisseurs (histoire, lignée, psychologie, condition sociale, etc.). Aussi, le schéma narratif aurait pu être celui d’un couple qui quoi qu’adolescent assume ses actes au lieu de nous proposer la même fuite en avant du garçon et l’arrière-plan pro-féministe que cela suppose… Grosso modo, il y avait de quoi faire un ouvrage plus ambitieux. Mais la donne veut que la prolixité soit devenue la quête première et on passe outre la créativité langagière et on en oublie ce leitmotiv classique : « Cent fois… l’ouvrage ». Quelle est donc cette littérature gabonaise qui ne veut plus écrire des œuvres de fiction de plus de 300 pages ? Pourquoi tant d’empressements chez les jeunes auteurs ? Pourquoi ce manque de profondeur ? Pourquoi ces ambitions minimalistes ? Pourquoi, pourquoi et pourquoi ? Ah, c’est vrai, « les Gabonais n’aiment pas lire ». Que nous sommes bête. Mais oui. Tout s’explique…
Alors deux choix s’offrent aux lecteurs : soit ils sont puristes (c’est notre posture) et ils vont à la découverte d’une plume naissante, soit ils sont (trop) exigeants et se disent : « Pourquoi perdre mon temps si j’ai déjà lu La Mouche et la glu, Les Frasques d’Ebinto, L’Enfant noir, Maïmouna, etc. ?
Le Presque Grand Bounguili
[1] Réplique de Demolition man.
[2] Lieu de l’intrigue
[3] Nzeng-Ayong, quartier pouilleux de Libreville
[4] Organe censeur plus que régulateur au Gabon.
[5] Piment