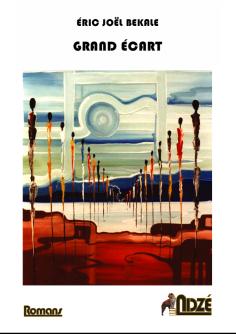De l’urgence d’être poète en temps d’indigence

DE L’URGENCE D’ÊTRE POÈTE EN TEMPS D’INDIGENCE
Qu’est-ce qui prime aujourd’hui pour un auteur actif ou en devenir: publier des ouvrages en vogue ou des idées, des romans ou des poésies, construire patiemment un style et une oeuvre pérenne ou succomber à la frénésie capitaliste ambiante. Au final, peut-on être écrivain sans être poète? Ce sont autant de questions que soulèvent cette rubrique que Le Chant de Powê vous invite à lire.
Nous sommes au XVIe siècle, en 1549, lorsque Joachim Du Bellay publie sa Défense et illustration de la langue française, texte dans lequel, il envisage la poésie comme outil pour parfaire la langue française et l’ériger en référence sinon en socle d’une identité française encore inexistante.
Le 5 février 2013, – le grand bond en avant est fait à dessein – au plus fort de la défense de la loi dite du mariage pour tous, Christiane Taubira, alors ministre Garde des sceaux de la France sous François Hollande convoquait ces vers de Léon Gontran Damas : « nous les gueux / Nous les peu/ Nous les chiens/ Nous les riens/ Nous les maigres/ Nous les nègres/ Qu’attendons-nous pour faire les fous/ Pisser un coup sur cette vie stupide et bête/ Qui nous est faite ».
Le 6 décembre 2015, un mois après les inqualifiables attentats de Paris, le Front national est propulsé au-devant de la scène au travers des élections régionales en France, Edwy Plenel, dirigeant du journal numérique Médiapart prononce une sorte d’éditorial-manifeste : NOUS SOMMES REQUIS. Tout en sonnant le tocsin dans une république qui peu à peu se saborde aussi bien idéologiquement, philosophiquement que politiquement, il invite dans les locaux du journal Marc Oho Bambe aka Capitaine Alexandre. Slameur d’origine camerounaise, l’aède sera accompagné d’une kyrielle d’acteurs du verbe pour proposer la poésie comme palliatif à ces jours d’une tiède saveur et d’un sombre horizon. La poésie était sollicitée.
Le 9 mai 2019 paraît Poèmes de la résistance à l’initiative de la poétesse canadienne francophone Andrée Lacelle. Ce recueil collectif regroupant trente-sept auteurs se prononce contre toutes les mesures visant à supprimer les outils de promotion de la langue française dans le Canada en général et dans certaines provinces bilingues en particulier. Le contexte est que le Canada étant majoritairement anglophone, les francophones imaginent, conçoivent des moyens de résister à l’écrasement de leur identité notamment la perdition de leur langue.

Alors qui convoque-t-on quand l’humanité trébuche et que le chemin devant nous devient moins sûr? On paraphraserait volontiers Pierre Claver Akendengue en répondant : « Des poètes, des poètes, des poètes »[1] Comme on peut le voir, que l’on recule ou que l’on élargisse la borne chronologique, la poésie est de tous les combats et de toutes les urgences : affirmation identitaire, revendication de la différence et/ou contestation d’un ordre établi oppresseur, conjuration des peurs et autres passions tristes. Mais une certaine rengaine, serinée à tout va, vise à présenter la poésie comme un art ou dépassé ou trop élitiste voire trop confidentiel et surtout insolvable et donc incapable de hisser le poète aux nuées de la reconnaissance. C’est dans cette optique qu’il faut accueillir ce propos de Charline Effah qui (dé)conseillait : « Ne perdez pas du temps à écrire de la poésie. Je vous encourage à écrire du roman. »[2] Situé dans un contexte national autre que le Gabon, la déclaration avait tout pour faire se lever même un cul-de-jatte. Mais il faut croire que dans ce qu’il reste du pays de Ndouna Depenaud, sous prétexte de ne détester personne et de ne pas envier le succès d’autrui, on a érigé le silence complice en norme intellectuelle. Il n’y a qu’au Gabon en effet que pareils propos ne suscitent que des réactions partagées entre silence mortifère, lieux communs et réprobations tacites. Et dire que la poésie gabonaise compte tout de même ses « cinquante grandes figures » …

Ce qui peut davantage surprendre c’est la confrontation de cette déclaration face aux œuvres de son auteur : un abysse. Tout cela est possible parce que ce qui est le plus admis de nos jours est qu’on écrit pour bénéficier d’un capital social et économique et non pour investir les imaginaires. On écrit pour être capable d’arborer chapeau, lunettes, écharpe et autres artefacts ridicules autour du cou pour se donner de la contenance ou un semblant de singularité. Le tout, bien accompagné d’une puérile mise en scène de soi, à travers une iconographie égotique tant vantée dans les médias sociaux. Alors qu’on n’en est que le pantin. Et il n’y a qu’à eux qu’on ne l’a pas dit. Nous paraphrasons. Et sans doute s’agit-il aussi un peu d’eux lorsque Michel Onfray dit : « Certains poètes contemporains donnent l’impression de n’être que des cerveaux, de purs produits de matière grise tarabiscotée. Quelques mots sur une page, des collisions verbales aléatoires, un vague tropisme mallarméen, un culte du mot seul, une religion de la phrase pour elle-même, une manie du blanc et de l’espace, de quoi générer un autisme de bon aloi, et s’assurer qu’on ne sera pas lu, aimé, compris. De quoi aussi, bien sûr, certifier qu’on a affaire au grand poète. Car ils aiment l’ineffable, scénographient l’indicible, se pâment en dévots de la théologie négative »[3]
En gros, la poésie en particulier et la littérature en générale sont parasités par des auteurs qui dans leur ensemble s’exercent d’abord à exister. Et la poésie étant ramenée à un niveau trivial, elle ne sert plus qu’à quelques vibrions désireux de porter vaille que vaille le label écrivain. Souvent, non satisfaits du mot écrivain trop maigre pour leur égo gargantuesque, ils cumulent les dénominations. Dans cette comique labellisation des dehors, comment ne pas y voir, les gestes insidieux de la dictature? Les littérateurs gabonais trainent un passif. Au point que dans leur façon de se dire, on croirait entendre des titres de ministres. Titres ronflants. Coquilles vides.
A propos de Charline Effah, Mabanckou disait qu’elle était une plume valable, apte aujourd’hui à porter haut le flambeau de la littérature gabonaise. L’écrivain congolais renonçait par la même occasion à l’idée parcellaire qu’il se faisait de la littérature gabonaise. Ceux qui seraient sceptiques à l’égard d’un tel adoubement, trouveraient comme nous, réponse dans N’Être mais surtout dans La Danse de Pilar. Un tel dévolu cache difficilement une accointance intellectuelle entre les deux auteurs… Mais ladite accointance ne profite visiblement pas à Charline Effah. Celle-ci, si elle avait fréquenté consciencieusement les œuvres poétiques de Mabanckou, aurait proposé à son auditoire de ce jour-là bien mieux que ce propos définitif qui entache l’opinion respectable qu’on peut avoir d’elle via ses écrits et accessoirement son profil académique. En effet, dans son recueil Tant que les arbres s’enracinent dans la terre (2007), Mabanckou produit ce qui à nos yeux est un de ses textes les plus pertinents hors du registre fictionnel. Sa « Lettre ouverte à ceux qui tuent la poésie », propos liminaire du recueil, souligne fort justement que la poésie reste le socle de la littérature. Objet singulier et mutant, elle n’a pas perdu de sa fraîcheur mais a plutôt pris ses quartiers dans les autres genres littéraires. En somme, pratiquer le roman aujourd’hui et dénier voire dédaigner la poésie relève d’un étonnant contre-sens.
La poésie et les considérations mercantilistes ou capitalistes de l’art
Tout en s’exprimant au Gabon, la romancière s’énonçait non pas à partir du Gabon mais à partir de Paris. Ville snobinarde et qui culturellement a renoncé aux arts avant-gardistes selon une logique d’abaissement de la culture délaissée aux mains d’une caste d’usuriers. Il faut dire plus globalement que le propos de Charline Effah est révélateur d’une certaine époque. Celle qui soumet le livre, l’art, à leurs seules fonctions objectives : moyens d’entrance, blanc-seing de la reconnaissance et de la consécration, positions avantageuses et lucratives, etc. Pris de cette manière, effectivement, comment ne pas adhérer à la vulgate quand bien même ce propos est relatif? Car la liste est longue d’auteurs de renommée qui plus est vivent de leur art sans être romancier. Pour exemple, la littérature autochtone au Canada est largement poétique. Une de ses figures de proue est Joséphine Bacon pour ne parler que du cas du Québec, et chacune de ses publications est un succès de librairie. Mais nous ne sommes pas dupes et n’oserons aujourd’hui affirmer de façon péremptoire que l’art est gratuit. Mais s’il doit être payant c’est que ses bénéficiaires y mettent de la qualité.
Question de genre ou de qualité?
Il y a donc lieu d’adresser la question selon un paradigme différent. Pour ce qui nous concerne, la littérature gabonaise sortira de l’ornière lorsque tout un chacun aura intégré l’idée qu’en matière d’art, seules la singularité et la QUALITÉ sont les maîtres mots. La qualité surtout. Ce qui suppose une littérature ambitieuse, rigoureuse et surtout une masse critique qui promeut, étend et généralise le crépuscule des bons sentiments. Car tout n’est pas poésie. Tout n’est pas poétique.
La démission des maisons d’édition avant-gardistes telles que Présence africaine a desservi le genre. Logique capitaliste oblige, elle a emboité le pas aux maisons germanopratines. Cette démission généralisée a fait le lit de maisons d’éditions hétéroclites mues la plupart du temps par le gain, l’usufruit et non par une réelle portée esthétique et/ou idéologique. Le pire est que, parfois, le minimum de rigueur éditoriale n’y est souvent pas. Quand, à cela s’ajoute le fait que l’éditeur est aussi auteur, la course à l’exposition est d’emblée perdue par celui qui n’est qu’auteur et malheur à lui s’il est auteur de poésie. Ses recueils sont visibles partout mais disponibles nulle part. Quand ils le sont, ce n’est qu’après d’âpres batailles et autres contorsions à vous briser l’échine et l’élan qui va avec. Disons ici que si elle est mal distribuée ou absente des présentoirs et autres rayons, comment la poésie va-t-elle se vendre?
Aussi, faut-il rappeler que certaines prétendues grandes figures littéraires gabonaises ont publié leurs premiers romans dans des maisons d’édition parisiennes avant de rentrer docilement dans la confidentialité des éditions locales? Okoumba-Nkoghe, Justine Mintsa, etc. n’ont pas fait long feu alors que s’il suffisait de publier des romans aux dépens de la poésie, ils seraient primés et consacrés à Paris, ainsi que nombreux le souhaitent. Donc posons la question à l’endroit : les auteurs de la La Mouche et la glu (Présence africaine) et Histoire d’Awu (Gallimard) sont-ils revenus à des éditions locales pour des questions de genre ou de qualité? Aussi faut-il se remémorer ces mots de Sartre : « On n’est pas écrivain pour avoir choisi de dire certaines choses mais pour avoir choisi de les dire d’une certaine façon. Et le style fait la valeur de la prose »[4]. Dire d’une certaine façon c’est être original, différent novateur et ce qu’importe le genre.
Pour une résurgence de la poésie au chevet des urgences délaissées
Dire qu’il faille désormais privilégier le roman au détriment de la poésie, c’est considérer que ce genre, dans le contexte gabonais en l’occurrence, a suffisamment évoqué sa singularité. En réalité, quasi absente des grandes questions historiques de la marche du monde, la poésie gabonaise est loin d’avoir livré son fin mot de l’histoire. Elle est loin d’avoir énoncé sa versification de l’Histoire. Bien évidemment, lorsque cette poésie se sera suffisamment emparée du trauma et des impensés gabonais aux confluences des tourments du monde; lorsqu’on aura remis la poésie au centre du village ou de la cité comme manière de se manifester ou de signifier ses émotions; lorsqu’on aura intégré que faire de la poésie c’est chaque fois écrire comme Pessoa Le Livre de l’intranquillité, alors seulement, on cessera de faire passer la poésie pour ce qu’elle n’est pas. Bien évidemment, parvenir à ces visées nécessite de rompre avec un nombre accablant de malentendus. Lesquels amènent certains à croire que le simple fait d’aligner des bourbouilles de vers et de revenir chaque fois à la ligne suffit à nous consacrer poète d’anthologie. Et autant on dira tout ce qui brille n’est pas or autant il est valable de dire que tout ce qui rime n’est pas poésie. Et on paraphraserait volontiers Hölderlin pour interroger « Le pain est fruit de la terre, cependant est-il béni par la lumière[5]? »

La poésie fonctionne sur deux articulations : elle est un langage codé et intuitif (elle est donc inspirée) ou elle est construite à partir d’un positionnement (pensée). Mais dans un cas comme dans l’autre, le poète est invité à inventer sa langue. Car la poésie dénie à la langue normative et au langage usuel leurs prétentions objectives et les constructions toutes faites. Bien avant les théoriciens de la linguistique, les poètes ont été les premiers à comprendre le caractère spécieux des signes et des signifiants, des signifiés et des référents. Ainsi, aux « temps déchirés » doivent donc survenir des « élévations » (véritables celles-là), en appeler à la « force disloquante » (sic) qui, à l’instar de Depestre sublime « l’élargissement de la culture nationale » et la ‘’libération de l’imaginaire »[6] gabonais. Englué qu’il est, ce dernier, dans les rêves cadenassés des politiques, ces « tigres déguisés en citoyens »[7]
Reprendre possession du monde et des choses : des idoles à brûler
Michel Onfray estime que les prédictions orwelliennes sont en passe de se concrétiser et ce plus tôt que l’horizon 2050 suggéré par l’écrivain britannique. Ces prédictions annoncent l’avènement d’une dictature d’un type nouveau, à la fois insidieux et violent. Sur le plan culturel, l’adoption du novlangue, sorte de langue bâtarde, avachie et dénutrie, serait l’un des signes de cet état de dictature. Or, qui mieux que le poète peut aller à la source des choses et des mots, à l’instar des fameux lamentins senghoriens? Aussi, à l’instar de Du Bellay, le poète doit reprendre sinon arracher les pouvoirs confisqués. Ce qui passe nécessairement par une langue qui a une prise sur les choses. Aussi, nous dit encore Michel Onfray, « La révolution dans les choses ne va pas sans la révolution dans les mots – et vice versa – (…) L’articulation entre le signifiant, qui dit la chose, et le signifié, la chose dite, est le cœur nucléaire de la prise de pouvoir sur le monde – sur le monde des choses et sur les choses du monde. »[8] Une telle démarche, en contexte d’oppression – à partir de laquelle le poète écrit – ne peut servir qu’à empêcher le rétrécissement du champ de la conscience, des rêves, des imaginaires, de la propulsion de l’individu dans tout son potentiel, dans toute son envergure. Ainsi, face à un système visant à « Empêcher tout ce qui permet de raisonner, de réfléchir, de penser, de concevoir, de spéculer » en somme, une époque qui poursuit le sombre dessein de « déculturer un individu »[9], doit se dresser le poète face à cet ordre nébuleux.
La poésie gabonaise, pour sa part, doit inventer son moment, son grand bûcher sur la place publique. Et intenter ainsi le vaste procès contre les auteurs du « deuil des choses »[10] infligé par l’histoire des autres, et prolongé par les apôtres des ténèbres équatoriales. Elle doit pousser un cri semblable à un kiai tellurique sinon sismique. Un héritage largement poltron et donc vicié enserre encore trop sa voix. Il est venu le temps de flétrir les idoles, de les briser pour ensuite les brûler. Qu’on se le dise bien le feu ici, est intellectuel. La précision est de taille car certains esprits bas du front y verraient – non sans malveillance – un appel à l’extrémisme. C’est à la remise en cause de tous les fonts baptismaux friables, érodés et sentant la naphtaline que requiert notre époque. Et la poésie doit être de ce mouvement-là. Ou le Gabon intellectuel ne sera pas. Et par idole, il faut entendre tous ces égrégores producteurs de fariboles et affublés de masques politiques; acteurs culturels, lieux de la culture, tous célébrés malgré la sénescence de leurs productions.
Aller contribuer à la maturation concrète des rêves
D’aucuns reprocheraient à la poésie de ne pas faire « rêver ». Mais à qui la faute si « les voiles au loin descendant vers Harfleur » (Hugo) ne les font pas rêver? A qui la faute si le rappel des usages et des interdits ne les invite à communier avec les valeurs du pays d’antan ainsi que le souligne Ndouna Depenaud à travers « Respecte »[11] ? Mais précisément, la poésie va bien au-delà. D’aucuns pensent qu’ils peuvent faire de la poésie en la considérant comme un gâtisme qui n’engage à rien. Or, Victor Hugo nous enseigne que ses discours enflammés à l’assemblée nationale française rejoignent sa puissante indignation sur le travail des enfants dans Melancholia.
Il faut absolument lire. Lire notre époque : ses signes autant que ses acteurs et surtout apporter une voix/e de résistance contre ce sentiment qui gagne davantage les esprits et qui invite à célébrer l’insignifiance. Ce qui signifie sortir la poésie des considérations triviales et être de cela qui en revanche « croient que le mot ne constitue pas une fin mais un moyen. Le poème? Sûrement pas un artifice de pure forme, un artefact de technicien de l’écriture, mais une prose revendiquant sa matérialité, sa musicalité, le rythme et la cadence des vocalises primitives de l’Homo sapiens »[12].
Ceux qui pratiquent la littérature en dédaignant la poésie (en refusant ou de la lire ou de la pratiquer même en secret) se privent d’une partie d’eux-mêmes, du riche imaginaire de leur sensibilité. C’est un peu comme si Aladdin jetait la lampe dans une cave aux antiquités, ignorant du génie qui pourrait y éclore. Ils courent par ailleurs le risque de bâtir un ensemble bibliographique dévitalisé, et devront se demander si au bout de deux œuvres, ils ont construit un projet littéraire pérenne ou une simple distraction à ranger au rang de littérature de gare. Et ainsi que le souligne Mabanckou, la réussite de certains romanciers est peut-être la résultante d’une maîtrise de la poésie et de son insertion en prose. Aussi peut-on méditer sur ce propos selon lequel la poésie « accompagne la prose, lui prend la main, lui prend la main, la séduit, la rend grave, profonde, sinueuse mais virulente afin de traverser le marasme dans lequel s’est empêtré le roman contemporain. »[13]
Écrire au milieu de la chair du peuple.
Récemment encore, Alain Mabanckou annonçait que les éditions du Seuil lui avait confié la direction d’une collection poétique. Pareil « revirement » devrait nous interpeler sur le regard que l’on porte sur la poésie. Par ailleurs, aussi bien Mabanckou que Gaël Faye, René Depestre, Aimé Césaire, Sony Labou Tansi, etc. ce sont autant d’auteurs qui ont excellé dans d’autres genres après avoir laissé macérer leur langue dans le moule incandescent et modélisateur de la poésie ou tout en restant proche d’elle. Écrire aujourd’hui, pour tout Gabonais, peu importe le genre, consiste à PRENDRE LA PAROLE ainsi que le dirait Larry Essouma. Or, nous enseignait Sartre, parce qu’il a une conscience d’oppressé, celui qui prend la parole sait que « la parole est action »[14]. Et nous de compléter, prendre la parole et l’assumer. À la manière des griots, des mvettistes, et autres okambi, le poète initie ou doit initier un dialogue avec sa communauté. Et à défaut de dialogue, il s’agit de parler pour elle, poser un micro au corps social pour donner à chacune de ses plaies un droit de cité, un droit de « paroler ». Ainsi que le disait encore Hölderlin, les hommes sont riches en mérites, mais ils habitent la terre en poète[15]. Il revient donc aux poètes gabonais de ressusciter les ancêtres et les dieux anciens Nous l’entrevoyons ainsi afin de « demeurer éveillé dans la nuit »[16]
Le presque Grand Bounguili
[1] PCA, « Le Conte d’Oreï I »
[2] Propos tenus à Libreville au Club Lyre et que rapporte Rodrigue Ndong sur la page dédiée : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2201423743520407&set=gm.2250988561806209&type=3&eid=ARB5DEvBJKL7nBcr6Pt7zioq-nAQpeWriivYxV2mYpfB0ZPx5Mk-MdvqnSez7ePCru_Y3yoicf5wqlO2&ifg=1
[3] Michel Onfray, ‘’La chair des langues d’esclaves’’, préface de Non-assistance à poètes en danger, de René Depestre.
[4] J-P Sartre, Situations III
[5] F. Hölderlin, « Pain et vin »
[6] René Depestre introduction à Étincelles.
[7] René Depestre, ‘’Je connais un mot’’ in Étincelles.
[8] Michel Onfray, Théorie de la dictature, Robert Laffont, 2019
[9] Id.
[10] Pierre-Edgar Moundjegou, « Réveil de l’Afrique »
[11] Ndouna Dépénaud, « Respecte »
[12] Michel Onfray, « La chair des langues d’esclaves », op. cit.
[13] Alain Mabanckou, « Lettre ouverte à ceux qui tuent la poésie » in Tant que les arbres s’enracinent dans la terre.
[14] Jean-Paul Sartre, Situations III.
[15] Hölderlin, « En bleu adorable ».
[16] Hölderlin, « Pain et vie ».